L’interruption d’un chantier pour cause de chauves-souris n’est plus un scénario rare. Sur le terrain, on voit des projets retardés par la découverte inopinée de ces discrets mammifères protégés. Par exemple, la démolition programmée d’une tour à Bourges a dû être repoussée car environ 200 chauves-souris y hibernaient en hiver, obligeant le bailleur à attendre la fin de l’hibernation. De même, près de Nantes, un projet de déviation routière a pris un an de retard après la mise en évidence tardive d’une importante colonie de chiroptères à proximité du tracé(source : lefigaro.fr ).
Ces situations illustrent combien négliger les chauves-souris dans une étude d’impact peut entraîner des coûts supplémentaires, des délais et des risques juridiques. Comment éviter de tels écueils ? En intégrant dès le départ la détection acoustique (bioacoustique) des chauves-souris dans les études environnementales, afin de respecter scrupuleusement la réglementation relative aux espèces protégées tout en sécurisant ses projets.
Un cadre réglementaire strict pour les chauves-souris en France
En France, toutes les espèces de chauves-souris font l’objet d’une protection légale intégrale depuis 1981. Autrement dit, le Code de l’environnement interdit toute destruction, capture, perturbation intentionnelle des chauves-souris, de même que la dégradation de leurs sites de reproduction ou de repos, sauf dérogation exceptionnelle délivrée par l’État Porter atteinte à ces animaux ou à leurs habitats constitue un délit pénal passible de jusqu’à 3 ans d’emprisonnement et 150 000 € d’amende. Ces sanctions lourdes – doublées en cœur de parc national ou de réserve naturelle – traduisent l’importance accordée à la préservation des chiroptères. Même en dehors d’espaces protégés, la seule présence d’une espèce protégée confère une protection au site : nul n’a le droit d’endommager un milieu occupé par des chauves-souris sans autorisation .
Des dérogations aux interdictions sont prévues par la loi, mais uniquement dans des cas très restreints. L’article L.411-2 du Code de l’environnement énonce trois conditions cumulatives pour qu’une dérogation « espèces protégées » puisse être accordée:
- Absence d’autre solution satisfaisante : le projet ne doit avoir aucune alternative réalisable sans impact sur l’espèce concernée.
- Raison impérative d’intérêt public majeur : le projet doit répondre à un enjeu crucial (sécurité publique, santé, intérêt socio-économique majeur, etc.) justifiant qu’on porte atteinte à l’espèce.
- Maintien d’un état de conservation favorable : les populations locales de l’espèce impactée doivent pouvoir être maintenues dans un état de conservation satisfaisant dans leur milieu naturel.
En pratique, remplir ces critères est difficile : les dérogations pour nuire à des chauves-souris sont rarissimes. Les maîtres d’ouvrage le savent bien, ils doivent tout mettre en œuvre pour éviter d’impacter ces espèces protégées, ce qui commence par des inventaires écologiques approfondis en amont du projet. Autrement dit, mieux vaut prévenir que guérir : il est indispensable d’identifier dès la phase d’étude d’impact la présence éventuelle de chauves-souris et les enjeux associés, afin de concevoir un projet respectueux de la réglementation.
Études d’impact : l’obligation d’inventaire des chiroptères

Dans le contexte des études d’impact environnemental, recenser la faune protégée est une obligation légale. Tout projet soumis à évaluation environnementale doit comporter une étude d’impact incluant un inventaire naturaliste du site. Les chauves-souris, protégées par la loi, requièrent donc une attention particulière lors de ces études. Ce principe découle de l’approche « éviter-réduire-compenser » : on ne peut éviter ou atténuer un impact que si l’on a correctement évalué la présence de l’espèce concernée. Ainsi, omettre de rechercher des chauves-souris sur une zone de projet, c’est produire une étude lacunaire qui pourrait ultérieurement être jugée non conforme sur le plan juridique .
Concrètement, pour tout projet d’aménagement, le maître d’ouvrage et le bureau d’études doivent documenter la présence des chauves-souris par des prospections appropriées (périodes et méthodes adaptées). S’il apparaît a posteriori qu’une colonie de chiroptères avait été ignorée, le projet peut être remis en cause : un juge administratif considérera l’étude d’impact insuffisante et pourra en déduire qu’une demande de dérogation aurait dû être déposée avant l’autorisation du projet. Autrement dit, une étude d’impact incomplète expose le projet à un blocage (en attendant des compléments d’enquête) voire à une annulation pure et simple pour non-respect des obligations réglementaires. Plusieurs juridictions ont d’ailleurs annulé des permis de construire pour ce motif, même si ceux-ci respectaient par ailleurs les règles d’urbanisme, au motif que l’étude écologique était insuffisante sur les espèces protégées. Le Conseil d’État a également rappelé en 2022 que dès qu’un risque non négligeable pèse sur une espèce protégée, une dérogation doit être sollicitée avant de réaliser le projet .
Bon à savoir :
Dans les secteurs couverts par le réseau Natura 2000, les exigences sont renforcées. Si un projet est susceptible d’affecter un site Natura 2000 désigné pour la conservation de chauves-souris, il doit faire l’objet d’une évaluation d’incidences Natura 2000 spécifique.
De nombreuses espèces de chiroptères figurent sur la liste des espèces d’intérêt communautaire justifiant la création de sites Natura 2000. L’étude d’incidences évalue les effets du projet sur les habitats et populations ayant motivé la désignation du site, et vérifie que les objectifs de conservation ne seront pas compromis. Là encore, des inventaires de terrain rigoureux sont indispensables pour appuyer ce dossier : un document d’incidences mal renseigné sur la présence de chauves-souris risque de se solder par un avis défavorable de l’autorité environnementale, ou d’être retoqué en contentieux par les tribunaux.
Enfin, si malgré toutes les précautions un projet prévoit inévitablement la destruction ou la perturbation de chauves-souris, une demande de dérogation “espèces protégées” est obligatoire avant travaux. Il ne suffit pas de mentionner quelques mesures d’atténuation dans le rapport d’étude : il faut obtenir formellement une autorisation pour pouvoir impacter l’espèce légalement. Ne pas le faire expose le maître d’ouvrage à un refus d’autorisation environnementale en phase d’instruction, ou à des sanctions a posteriori si l’atteinte illégale aux chauves-souris est constatée plus tard .
Bioacoustique : un outil indispensable pour l’inventaire des chauves-souris

Identifier la présence des chauves-souris pose un défi particulier, car ce sont des animaux difficiles à détecter à l’œil nu. Espèces majoritairement nocturnes, petites et furtives, elles échappent souvent aux observations visuelles classiques. C’est là qu’intervient la bioacoustique, c’est-à-dire l’écoute et l’analyse des ultrasons émis par les chauves-souris. Chaque espèce de chiroptère émet des cris d’écholocalisation à des fréquences et selon des motifs qui lui sont propres. En déployant sur site des détecteurs d’ultrasons (appareils enregistreurs fonctionnant du crépuscule jusqu’à l’aube), il est possible de capturer ces signaux acoustiques et de détecter ainsi le passage des chauves-souris, même sans les voir. Ensuite, grâce à des logiciels spécialisés, on analyse les enregistrements obtenus pour identifier les espèces présentes (en reconnaissant la « signature » de leurs sonagrammes) et évaluer leur activité (nombre de contacts, comportements de chasse, de transit, etc.) sur le site étudié.
Cette méthode acoustique est aujourd’hui centrale dans les inventaires de chiroptères, car elle offre de nombreux avantages. Son efficacité de détection est élevée : un détecteur déployé plusieurs nuits peut balayer une grande étendue, y compris dans des milieux difficiles d’accès, et repérer un maximum d’espèces différentes avec un effort moindre qu’une capture physique. Il s’agit en outre d’une approche non invasive : on ne manipule pas directement les animaux, évitant stress ou blessure, ce qui est un gage de conformité éthique et réglementaire (pas de perturbation directe). Enfin, la bioacoustique permet de couvrir simultanément plusieurs sites et de répéter les suivis aisément, grâce à une logistique allégée (pose et récupération d’enregistreurs autonomes). Pour toutes ces raisons, l’inventaire acoustique est souvent considéré comme la meilleure méthode pour détecter le plus grand nombre d’espèces de chauves-souris sur un site – un atout précieux pour fiabiliser les études d’impact.
Il convient toutefois de noter que la bioacoustique a ses limites, d’où l’importance de la complémenter par d’autres approches dans certains cas. Par exemple, certaines espèces “cryptiques” émettent des ultrasons très similaires, qu’il est difficile voire impossible de distinguer avec certitude par l’analyse acoustique seule. C’est le cas de nombreux Murins (genre Myotis) dont les signaux se chevauchent : sans capture au filet pour examiner l’animal de près, on ne pourra pas identifier l’espèce exacte. De même, un enregistrement de mauvaise qualité (parasité par le vent, la pluie, ou trop bref) peut empêcher de trancher entre deux espèces proches. L’interprétation des sonagrammes requiert donc une expertise pointue. Un opérateur non formé risque l’erreur d’identification, avec toutes les conséquences que cela induit (louper une espèce protégée présente, ou à l’inverse en signaler une qui n’y est pas).
Face à ces défis, les bureaux d’études doivent acquérir une compétence bioacoustique solide en interne, ou s’entourer de spécialistes, pour tirer le meilleur parti de cet outil. L’analyse des milliers de sons enregistrés est un travail d’expert, faisant appel à des connaissances approfondies en acoustique des chiroptères et à de l’expérience de terrain. Les logiciels d’aide (classification automatique, filtres) sont utiles, mais le regard d’un bioacousticien expérimenté reste souvent indispensable pour valider les résultats. Une montée en compétences est donc incontournable pour qui veut réaliser des inventaires acoustiques fiables et complets. À ce titre, investir dans la formation de ses écologues est un choix stratégique pour les structures amenées à étudier des chauves-souris. Par exemple, suivre une formation dédiée à la détermination bioacoustique des chiroptères – niveau intermédiaire permet d’acquérir les techniques d’analyse avancée des ultrasons et de gagner en autonomie sur ce type d’étude. En maîtrisant mieux l’identification acoustique des chauves-souris, un bureau d’études renforce sa capacité à identifier toutes les espèces présentes et à proposer les mesures adéquates pour les préserver.
(À noter : la question du choix méthodologique entre détection bioacoustique et capture au filet fait l’objet d’un débat. Chacune a ses mérites et contraintes. Nous l’avons exploré plus en détail dans un autre article de notre blog, « Inventaire des chiroptères : bioacoustique vs capture au filet », qui relaye notamment les recommandations officielles des instances comme le CNPN ou les DREAL.)
Risques en cas d’inventaire insuffisant : retards, sanctions et contentieux
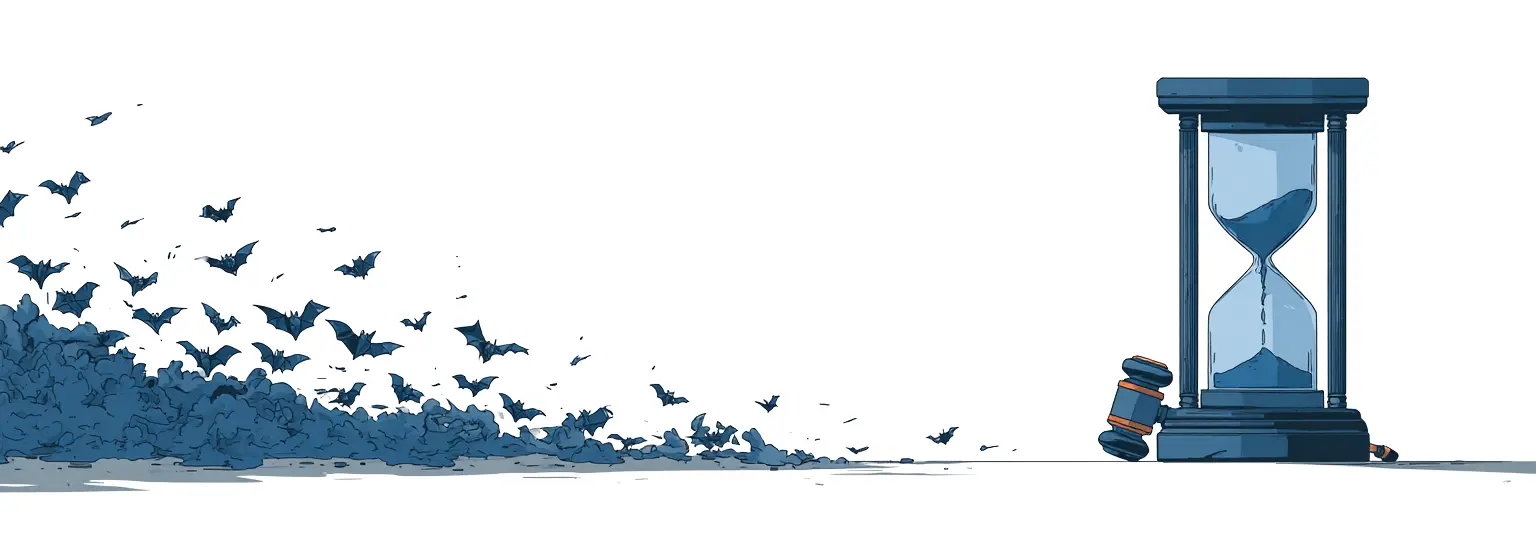
Compte tenu de ce cadre strict, omettre les chauves-souris ou bâcler leur inventaire dans une étude d’impact n’est pas une option sans conséquence. Les risques juridiques et opérationnels sont multiples :
- Sanctions pénales : réaliser des travaux ayant détruit ou perturbé des chauves-souris sans autorisation constitue une infraction. En cas de destruction illégale d’espèces protégées, le Code de l’environnement (art. L.415-3) prévoit jusqu’à 3 ans de prison et 150 000 € d’amende. Ainsi, un promoteur qui démolit un vieux grenier abritant une colonie, sans précaution ni dérogation, s’expose à des poursuites pénales.
- Recours administratifs et annulations de permis : un défaut d’étude sur les chauves-souris peut conduire à la suspension voire l’annulation d’une autorisation administrative (permis de construire, autorisation environnementale). D’une part, l’autorité environnementale pourra exiger des compléments d’étude en cours d’instruction, allongeant les délais d’examen du dossier. D’autre part, en cas de recours d’une association ou d’un riverain, le juge annulera le permis si l’étude d’impact est jugée insuffisante sur ce point. Il n’est pas rare que des projets pourtant bien engagés soient stoppés net par le tribunal pour inventaire biodiversité lacunaire. Récemment, plusieurs parcs éoliens ont ainsi dû être mis à l’arrêt et régularisés car leurs études n’avaient pas correctement pris en compte les chauves-souris, alors qu’une dérogation espèces protégées aurait dû être demandée en amont. Dans des cas extrêmes, un projet déjà construit peut même être remis en cause a posteriori : on a vu un jugement ordonner l’arrêt temporaire, voire la démantèlement d’éoliennes installées sans précautions suffisantes, le temps de remédier aux impacts sur les chauves-souris.
- Retards de chantier et surcoûts : indépendamment des tribunaux, découvrir tardivement des chauves-souris peut perturber le calendrier d’un projet. Nous l’avons vu en introduction, des chantiers doivent parfois s’interrompre pour respecter le cycle biologique des chiroptères. Attendre la fin de l’hibernation pour démolir un bâtiment, ou modifier un planning de travaux en pleine saison de reproduction, peut occasionner plusieurs mois de retard et des frais supplémentaires (démontage d’échafaudages, replanification, etc.). Ces aléas, qui auraient pu être anticipés par un inventaire initial complet, peuvent coûter cher et ternir l’image du projet auprès des partenaires et du public.
- Responsabilité du bureau d’études : en cas de manquement, le cabinet environnemental ayant réalisé l’étude d’impact engage aussi sa responsabilité. Il a un devoir de conseil vis-à-vis du maître d’ouvrage. S’il omet de détecter une colonie de chauves-souris importante ou s’il minimise leur présence, il induit son client en erreur quant aux risques du projet. Le maître d’ouvrage, confronté ensuite à un contentieux ou à un chantier arrêté, pourrait se retourner contre le bureau d’études pour faute professionnelle ou négligence. Au-delà du juridique, une telle erreur entamerait sérieusement la crédibilité et la réputation du bureau d’études (perte de confiance des autorités instructrices, des partenaires, etc.). À l’inverse, un bureau d’études proactif et rigoureux sur ces questions renforce sa fiabilité. C’est donc dans l’intérêt direct des consultants écologues de produire des inventaires chiroptérologiques les plus exhaustifs possible, garantissant la sécurité juridique des projets de leurs clients tout en contribuant concrètement à la protection de la biodiversité.
Monter en compétence en bioacoustique : un atout pour les bureaux d’études

Face à ces enjeux réglementaires et scientifiques, les bureaux d’études environnementales ont tout avantage à monter en compétence en bioacoustique. Développer une expertise interne en détection acoustique des chauves-souris offre plusieurs bénéfices stratégiques :
- Conformité réglementaire renforcée : en maîtrisant les protocoles acoustiques, l’équipe pourra détecter efficacement toutes les espèces présentes et éviter tout oubli préjudiciable dans les dossiers réglementaires. Une étude d’impact bien documentée sur les chauves-souris réduit considérablement le risque de recours ou de refus de la part de l’administration.
- Autonomie et réactivité : disposer de bioacousticiens en interne permet de réaliser rapidement les inventaires requis, sans dépendre entièrement de sous-traitants spécialisés souvent très sollicités au printemps/été. Le bureau d’études peut ainsi mieux contrôler ses délais et ses méthodes, et adapter les prospections en temps réel en fonction des premiers résultats.
- Valorisation de l’offre de services : sur un marché de l’environnement de plus en plus exigeant, afficher une compétence pointue en chiroptérologie est un atout commercial. Les maîtres d’ouvrage (collectivités, aménageurs, industriels) seront sensibles au fait que l’on puisse gérer en interne les enjeux chauves-souris, gage de sérieux. Cela ouvre la porte à des missions plus complexes (suivis acoustiques de longue durée, expertise sur des projets sensibles, etc.).
- Contribution à la biodiversité : au-delà de l’aspect légal, former ses équipes à mieux connaître les chauves-souris, c’est participer à un effort plus large de conservation de la biodiversité. Chaque inventaire bien mené enrichit la connaissance locale (données transmises aux bases naturalistes, aux plans d’action chiroptères, etc.) et aide à préserver des colonies fragiles en adaptant les projets. Cette plus-value écologique s’inscrit pleinement dans les objectifs de développement durable et peut donner lieu à une communication positive.
Pour atteindre ce niveau de compétence, il est recommandé de suivre des formations spécialisées. Par exemple, notre formation à la détermination bioacoustique des chiroptères – niveau intermédiaire offre aux écologues de terrain l’opportunité d’approfondir leurs connaissances sur l’identification des ultrasons de chauves-souris. Ce type de formation pratique et ciblée permet d’accélérer la courbe d’apprentissage, en se familiarisant avec les outils d’analyse acoustique, les répertoires sonores des différentes espèces et les astuces pour éviter les confusions. Les stagiaires y apprennent notamment à interpréter finement les sonagrammes, à reconnaître les cris caractéristiques des Pipistrellus, Rhinolophus, Myotis et autres, ainsi qu’à utiliser les logiciels d’aide à l’identification avec un esprit critique. Investir dans la montée en compétence bioacoustique, c’est s’assurer que son bureau d’études sera capable de fournir des inventaires chiroptères complets et fiables, donc de sécuriser les projets tout en participant activement à la préservation de ces espèces menacées.
Conclusion : vers une harmonie entre aménagement et préservation des chauves-souris

En conclusion, l’intégration de la bioacoustique dans les études d’impact environnemental n’est plus un luxe technique, mais bel et bien une nécessité réglementaire et écologique. Les chauves-souris, protégées depuis des décennies, imposent aux porteurs de projets un haut niveau de vigilance – vigilance qui, loin de freiner les projets, permet au contraire de les concilier durablement avec la protection de la biodiversité. En s’équipant des bonnes compétences et des bons outils acoustiques, bureaux d’études et maîtres d’ouvrage peuvent anticiper les contraintes plutôt que de les subir, évitant ainsi retards et contentieux. La réglementation ne doit pas être vue comme un obstacle, mais comme une opportunité d’améliorer nos pratiques : mieux connaître les chauves-souris grâce à la bioacoustique, c’est non seulement respecter la loi, mais aussi enrichir chaque projet d’une dimension environnementale positive. Il appartient désormais aux acteurs de l’aménagement de monter en première ligne pour intégrer ces exigences, et de prouver qu’avec de la préparation et du savoir-faire, il est possible de franchir un cap vers des projets réellement compatibles avec la préservation des chauves-souris.