Les chauves-souris font l’objet d’une protection légale stricte en France. Toute étude d’impact ou projet d’aménagement doit donc intégrer des inventaires acoustiques rigoureux pour détecter leur présence et respecter la réglementation. Dans cet article, nous détaillons le cadre juridique applicable, les obligations en matière d’étude d’impact environnemental, les exigences liées aux sites Natura 2000, la nécessité éventuelle d’une dérogation pour espèces protégées, ainsi que les conséquences en cas de non-respect de ces obligations. Nous illustrons également par des cas concrets (éolien, carrières, urbanisme…) où l’absence d’inventaire adéquat a entraîné des contentieux. Enfin, nous verrons comment les techniques de bioacoustique et la maîtrise du suivi acoustique des chauves-souris sont devenues indispensables pour se conformer à la loi – avec à la clé des suivis plus efficaces et rentables.
Le cadre juridique : une protection stricte des chauves-souris
En France, toutes les espèces de chauves-souris sont strictement protégées par la loi depuis 1981. Cela signifie qu’il est interdit de détruire, blesser, capturer ou perturber intentionnellement les chauves-souris, de même que de dégrader leurs sites de reproduction ou leurs gîtes, sauf dérogation exceptionnelle accordée par l’État. Cette protection s’appuie sur le Code de l’environnement – notamment les articles L.411-1 et suivants qui listent les interdictions – ainsi que sur les arrêtés ministériels fixant la liste des espèces protégées (par exemple l’arrêté du 23 avril 2007 couvrant tous les chiroptères). En d’autres termes, porter atteinte aux chauves-souris ou à leurs habitats constitue un délit pénal. Les sanctions prévues sont lourdes : jusqu’à 3 ans d’emprisonnement et 150 000 € d’amende en cas de destruction illégale d’une espèce protégée. Ces peines peuvent être doublées si l’infraction a lieu dans le cœur d’un parc national ou d’une réserve naturelle.
Il faut souligner que la seule présence d’une espèce protégée sur un site confère indirectement une protection au milieu : même si le site n’a pas de statut de réserve, toute action risquant d’endommager l’habitat de l’espèce est prohibée du fait de l’interdiction de porter atteinte aux individus qui s’y trouvent. Ainsi, par exemple, un bâtiment abritant des chauves-souris ou un alignement d’arbres contenant des gîtes sont protégés de facto par la présence de ces espèces.
Dérogations : des exceptions encadrées par la loi biodiversité
La loi pour la biodiversité (loi n°2016-1087) et le Code de l’environnement prévoient la possibilité de délivrer des dérogations aux interdictions précitées, mais sous conditions très strictes. Conformément à l’article L.411-2, une dérogation « espèces protégées » ne peut être accordée que si toutes les conditions suivantes sont remplies :
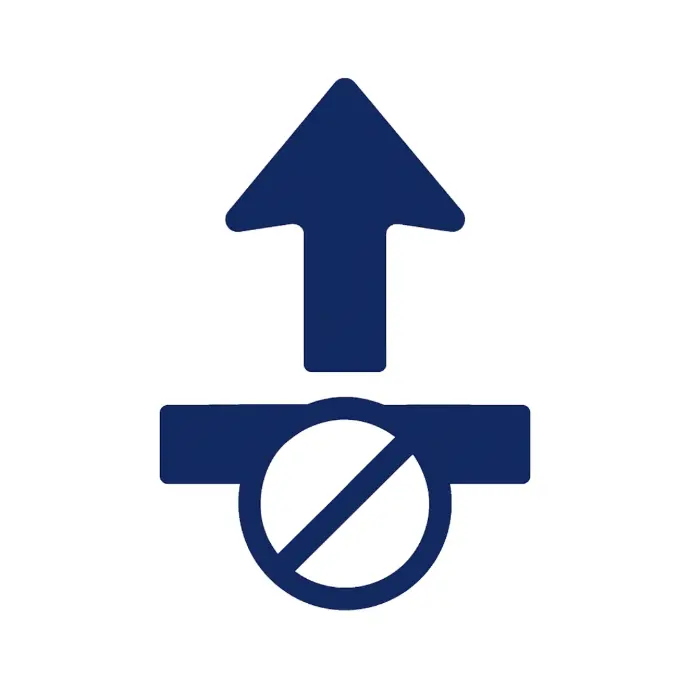
Absence d’autre solution satisfaisante :
le projet ne peut pas être réalisé autrement, sans impact sur l’espèce (pas d’alternative viable .

Raison impérative d’intérêt public majeur
le projet répond à un besoin crucial (sécurité publique, santé, intérêt socio-économique important, etc.) justifiant qu’on porte atteinte à l’espèce.

Maintien dans un état de conservation favorable des populations concernées
le projet (avec les mesures compensatoires proposées) ne doit pas compromettre la survie de l’espèce dans la région.
En pratique, obtenir une telle dérogation reste difficile et exceptionnel, d’autant plus pour des espèces aussi sensibles que les chauves-souris. Les porteurs de projet sont donc tenus d’éviter en amont tout impact sur les chiroptères, ce qui implique de réaliser des inventaires écologiques complets afin de détecter la présence de ces animaux et d’adapter le projet en conséquence. Comme l’indique notre article sur la protection stricte des chauves-souris, les bureaux d’études écologues sont en première ligne pour veiller au respect de cette réglementation, en conseillant les maîtres d’ouvrage et en conduisant des études naturalistes approfondies.
Étude d’impact environnemental : des inventaires obligatoires
Lorsqu’un projet d’aménagement est soumis à étude d’impact environnemental (évaluation environnementale), il est obligatoire d’identifier la faune présente sur le site, et tout particulièrement les espèces protégées comme les chauves-souris. En effet, le Code de l’environnement impose que l’étude d’impact comporte une description des effets du projet sur la biodiversité et les mesures pour les éviter ou les réduire (séquence « Éviter, Réduire, Compenser »). Ainsi, recenser les chiroptères via des inventaires de terrain (piégeages, observations et enregistrements ultrasonores) est une exigence réglementaire pour tout projet dans un secteur susceptible d’abriter ces espèces.
Cette obligation découle du principe d’évitement : on ne peut éviter ou atténuer les impacts sur une espèce protégée que si l’on a correctement évalué sa présence. Autrement dit, une étude d’impact qui omettrait de détecter des chauves-souris pourtant présentes serait juridiquement lacunaire. Le dossier du maître d’ouvrage pourrait être jugé non conforme et le projet bloqué le temps de réaliser une évaluation complète – voire annulé pour non-respect des obligations réglementaires. La jurisprudence récente l’a confirmé : un juge administratif n’hésitera pas à examiner lui-même les risques encourus par l’espèce si l’étude est insuffisante, afin de déterminer si une demande de dérogation aurait dû être déposée. En ce sens, ne pas mener d’inventaire sérieux expose le projet à un refus d’autorisation ou à une annulation en contentieux pour défaut d’étude d’impact.
Concrètement, quelles démarches suivre ? Le maître d’ouvrage doit diligenter une étude chiroptérologique complète, généralement confiée à un bureau d’études spécialisé. Cela comprend : des prospections aux saisons appropriées (printemps et été pour repérer les colonies de reproduction, automne pour les migrations, hiver pour d’éventuels gîtes d’hibernation), des inspections visuelles des gîtes potentiels (greniers, combles, arbres creux, caves…), et surtout des enregistrements acoustiques nocturnes à l’aide de détecteurs d’ultrasons. Les chauves-souris étant discrètes et actives la nuit, ces inventaires acoustiques sont primordiaux pour ne pas passer à côté d’espèces présentes. Il est recommandé de multiplier les sessions de suivi dans diverses conditions (météo, périodes d’activité) afin de maximiser les chances de détection. Un inventaire insuffisant constitue un manquement aux obligations : il peut conduire à des mesures de compensation inadaptées, à l’absence de demande de dérogation alors qu’elle aurait été nécessaire, et in fine exposer le projet – et le bureau d’étude – à de sérieux risques juridiques.
Exemple : Dans le cadre d’un projet de parc éolien en Ille-et-Vilaine, l’autorisation environnementale a été refusée par le préfet puis en justice, notamment parce que « aucune écoute en hauteur n’a été effectuée » et « aucune demande de dérogation à l’interdiction de destruction des espèces protégées n’a été présentée » par le porteur de projet (source : saint-malo.maville.com). Le site se situait dans une zone à fort enjeu chiroptères, et le juge a estimé que l’étude d’impact était incomplète sur ce point, justifiant le refus du projet. Ce cas illustre l’importance de réaliser des inventaires acoustiques adaptés, y compris en altitude pour les éoliennes (voir notre article sur les nouveaux protocoles acoustiques pour l’éolien), et de solliciter une dérogation si nécessaire.
Sites Natura 2000 : l’évaluation des incidences indispensable
Au-delà des procédures d’étude d’impact, un projet peut être soumis à une évaluation d’incidences Natura 2000 s’il est situé dans ou à proximité d’un site du réseau Natura 2000. Ces sites sont désignés pour la conservation d’habitats et d’espèces d’intérêt communautaire, et de nombreuses chauves-souris figurent parmi ces espèces (par exemple les Rhinolophes, certains Murins, le Grand Rhinolophe, etc.). Ainsi, si un projet est susceptible d’affecter un site Natura 2000 dédié aux chauves-souris, un dossier d’évaluation des incidences doit être réalisé.
L’objectif est d’analyser si le projet risque de compromettre les objectifs de conservation du site Natura 2000 concerné. L’étude d’incidences Natura 2000 doit donc évaluer en détail l’impact du projet sur les habitats et populations de chauves-souris ayant justifié la désignation du site. Ici encore, des inventaires naturalistes de qualité sont impératifs pour déterminer la présence et l’importance des chiroptères et, le cas échéant, proposer des ajustements au projet. Un dossier d’incidences mal documenté sur les chauves-souris exposera le projet à un avis défavorable de l’autorité environnementale, voire à être retoqué en contentieux si l’autorisation est attaquée
 À titre d’illustration, un projet d’aménagement à proximité d’une colonie de Grand Rhinolophe (espèce d’intérêt communautaire) devra démontrer qu’il n’a pas d’effet significatif sur cette espèce sous peine de refus ou de lourdes modifications. Les collectivités et porteurs de projet doivent donc intégrer cette contrainte dès la planification. Dans le cas contraire, un arrêté préfectoral délivré sans évaluation d’incidences satisfaisante pourrait être suspendu par le juge. Par exemple, dans le Gard, le tribunal administratif de Nîmes a bloqué un projet de centre de tri postal : le permis de construire en lui-même n’a pas été annulé, mais l’autorisation environnementale a été invalidée tant que l’étude relative aux chauves-souris n’était pas régularisée. Autrement dit, malgré un permis d’urbanisme conforme, le projet est resté gelé jusqu’à ce qu’une évaluation d’incidences Natura 2000 et/ou une demande de dérogation espèces protégées soient réalisées correctement. Ce cas rappelle que nul projet ne peut avancer si le volet biodiversité protégée n’est pas traité conformément à la loi.
À titre d’illustration, un projet d’aménagement à proximité d’une colonie de Grand Rhinolophe (espèce d’intérêt communautaire) devra démontrer qu’il n’a pas d’effet significatif sur cette espèce sous peine de refus ou de lourdes modifications. Les collectivités et porteurs de projet doivent donc intégrer cette contrainte dès la planification. Dans le cas contraire, un arrêté préfectoral délivré sans évaluation d’incidences satisfaisante pourrait être suspendu par le juge. Par exemple, dans le Gard, le tribunal administratif de Nîmes a bloqué un projet de centre de tri postal : le permis de construire en lui-même n’a pas été annulé, mais l’autorisation environnementale a été invalidée tant que l’étude relative aux chauves-souris n’était pas régularisée. Autrement dit, malgré un permis d’urbanisme conforme, le projet est resté gelé jusqu’à ce qu’une évaluation d’incidences Natura 2000 et/ou une demande de dérogation espèces protégées soient réalisées correctement. Ce cas rappelle que nul projet ne peut avancer si le volet biodiversité protégée n’est pas traité conformément à la loi.
Demande de dérogation espèces protégées : une étape incontournable le cas échéant
Lorsque les inventaires écologiques mettent en évidence la présence de chauves-souris protégées susceptibles d’être impactées de manière non négligeable par le projet, le maître d’ouvrage a l’obligation légale de solliciter une dérogation avant de réaliser les travaux. Il ne suffit pas d’annoncer quelques mesures d’atténuation dans l’étude d’impact : il faut obtenir formellement une autorisation pour pouvoir porter atteinte à l’espèce. En pratique, cela signifie constituer un dossier de demande de dérogation (souvent intégré aujourd’hui dans le dossier d’autorisation environnementale unique), comprenant une étude d’incidence sur l’espèce et des mesures compensatoires détaillées.
La jurisprudence récente a bien insisté sur ce point. Par exemple, dans une affaire de parc éolien, une association de protection de la nature a obtenu l’annulation de l’autorisation car aucune dérogation n’avait été demandée alors que l’étude d’impact révélait la présence de plusieurs chauves-souris protégées et un risque de mortalité non exclu malgré les mesures préventives proposées. Le juge a considéré que dès lors qu’un risque important pèse sur des espèces protégées, le porteur du projet doit déposer un dossier de dérogation – à défaut, l’autorisation peut lui être refusée ou retirée.
En clair, dès que l’étude montre qu’on ne peut totalement éviter d’impacter des chauves-souris, il faut prévoir cette démarche de dérogation. Ne pas s’y conformer expose le maître d’ouvrage à un refus d’autorisation par l’administration, ou à une sanction a posteriori si l’infraction est constatée après coup. Notons qu’avec la mise en place des autorisations environnementales uniques, la demande de dérogation espèces protégées est généralement instruite en même temps que l’étude d’impact et l’enquête publique : elle fait partie intégrante du dossier réglementaire. L’autorité environnementale (mission régionale de l’autorité environnementale, Conseil National de la Protection de la Nature pour avis, puis préfet pour décision) examinera attentivement la complétude de l’inventaire, la pertinence des mesures ERC (Éviter, Réduire, Compenser) et le respect des trois conditions légales évoquées plus haut avant de statuer sur la dérogation.
Risques et conséquences en cas de non-respect des obligations
Ne pas respecter la réglementation sur les chauves-souris peut avoir de lourdes conséquences, tant pour le porteur de projet que pour le bureau d’étude. Voici les principaux risques encourus en cas d’inventaire insuffisant ou de manquement aux procédures :

Sanctions pénales
réaliser des travaux ayant détruit ou perturbé des chauves-souris sans autorisation constitue une infraction pénale. L’article L.415-3 du Code de l’environnement prévoit jusqu’à 3 ans de prison et 150 000 € d’amende pour la destruction illégale d’espèces protégées. Par exemple, la démolition d’un bâtiment abritant une colonie sans précaution préalable peut tomber sous le coup de cette loi. Ces peines peuvent viser aussi bien le maître d’ouvrage que l’entreprise exécutante ou le responsable de l’étude ayant omis le signalement.

Contentieux administratif (annulation de permis)
Un projet soumis à autorisation (permis de construire, autorisation environnementale ICPE, etc.) risque d’être retardé voire annulé si l’étude d’impact n’a pas correctement pris en compte les chauves-souris. L’autorité environnementale pourra exiger des compléments d’étude, allongeant les délais d’instruction, et en cas de recours d’une association, le juge pourra censurer l’autorisation délivrée pour inventaire incomplet. Ces dernières années, plusieurs permis ont été annulés ou suspendus par le juge au motif que l’étude biodiversité était lacunaire et qu’une dérogation espèces protégées aurait dû être sollicitée. Dans des cas extrêmes, un projet déjà construit peut même être remis en cause : un parc éolien édifié sans étude suffisante pourrait se voir imposer des mesures d’arrêt temporaire, voire un démantèlement judiciaire si la violation de la loi sur les espèces protégées est avérée.

Responsabilité civile et financière
indépendamment du pénal, des associations ou tiers lésés peuvent demander en justice la réparation du préjudice écologique. Par exemple, en 2021, des exploitants de parcs éoliens ont été condamnés à verser des dommages-intérêts à France Nature Environnement suite à la destruction non autorisée de chauves-souris par leurs éoliennes. De tels contentieux restent rares, mais ils soulignent que la responsabilité financière du maître d’ouvrage peut être engagée si une insuffisance d’étude conduit à la mort d’animaux protégés. De plus, un chantier arrêté en cours de route pour cause d’inventaire incomplet génère des surcoûts importants (pénalités de retard, modification des travaux, etc.).

Atteinte à la réputation et responsabilité professionnelle
Le bureau d’études écologiques qui a réalisé l’inventaire peut voir sa responsabilité engagée par son client. Il a en effet un devoir de conseil et de diligence. S’il omet de détecter une colonie de chauves-souris importante ou minimise les impacts, il induit le maître d’ouvrage en erreur et l’expose à des sanctions . Le client, confronté à un contentieux ou à des coûts supplémentaires (arrêt du chantier, mesures correctives imprévues), pourrait se retourner contre le bureau d’étude pour faute professionnelle ou négligence. Au-delà des aspects juridiques, un manquement grave ternit la crédibilité du bureau d’étude vis-à-vis des autorités et partenaires, ce qui peut nuire à son activité. Il est donc dans l’intérêt des consultants de produire des inventaires les plus fiables possible, afin de sécuriser juridiquement les projets tout en protégeant effectivement les chauves-souris .
Exemples marquants : Nous avons déjà cité le parc éolien de Sixt-sur-Aff refusé en 2023 en raison d’un inventaire chiroptères insuffisant(source : saint-malo.maville.com). On peut ajouter le projet d’exploitation de carrière de Vaujours (Seine-Saint-Denis) où, en 2024, le tribunal a suspendu l’autorisation en attendant des mesures supplémentaires : l’arrêté initial autorisait la destruction de gîtes de 32 espèces protégées (dont 7 espèces de chauves-souris) sans compensation suffisante, ce qui a conduit le juge à exiger une régularisation sous 9 mois. Ces affaires montrent que le non-respect des obligations réglementaires liées aux chauves-souris entraîne quasi systématiquement des retards, des contentieux ou des refus de projet. A contrario, les maîtres d’ouvrage qui anticipent ces enjeux (en réalisant en amont de bons diagnostics écologiques et en ajustant leurs plans) parviennent généralement à éviter de tels déboires.
L’apport de la bioacoustique : vers des suivis acoustiques efficaces et conformes
Face à ces exigences, la maîtrise des techniques de bioacoustique est devenue un atout incontournable. En effet, la plupart des chauves-souris ne peuvent être détectées que grâce à leurs cris ultrasonores émis en vol nocturne. L’utilisation de détecteurs d’ultrasons permet de capter ces signaux inaudibles et d’identifier les espèces présentes en analysant leurs sonagrammes . Un inventaire acoustique bien conduit fournit des données précieuses sur les espèces de chiroptères fréquentant un site, leur niveau d’activité, leurs habitats de chasse, etc., ce qui oriente les mesures d’évitement et de réduction d’impact.
La méthode acoustique présente de nombreux avantages pour réaliser des suivis complets tout en optimisant les moyens mobilisés. D’une part, elle offre une efficacité de détection élevée : un même enregistreur peut fonctionner toute la nuit et sur plusieurs nuits, captant un maximum d’espèces avec un effort réduit par rapport à des méthodes visuelles ou de capture. D’autre part, c’est une technique non invasive qui n’induit aucun stress pour les animaux et perturbe très peu leur comportement . Elle permet en outre d’échantillonner une grande variété de milieux, y compris difficiles d’accès ou en hauteur (canopée, pylônes d’éoliennes), là où poser des filets serait ardu. Enfin, la logistique est légère : installer des enregistreurs puis revenir les collecter requiert moins de personnel en continu sur le terrain, ce qui facilite le suivi simultané de plusieurs sites . En ce sens, la bioacoustique contribue à des suivis plus rentables et efficaces, en optimisant le ratio effort/résultats.
Cependant, il ne suffit pas d’enregistrer des ultrasons – encore faut-il les interpréter correctement. L’analyse des sons récoltés peut représenter des milliers de fichiers et nécessite une expertise pointue. Certaines espèces ont des signaux très proches les uns des autres, ce qui rend l’identification formelle délicate dans certains cas. Un enregistrement de mauvaise qualité peut empêcher de trancher entre deux espèces similaires (par exemple des Murins du genre Myotis), et plusieurs Pipistrelles partagent des plages de fréquence semblables. Sans une solide expérience en bioacoustique, le risque d’erreur d’identification est élevé : un observateur peu averti peut confondre une espèce rare avec une commune, ou passer à côté d’une espèce discrète. De telles erreurs faussent l’évaluation des impacts et peuvent conduire à des décisions inappropriées (mesures de protection insuffisantes, absence de dérogation demandée alors qu’il en aurait fallu une, etc.), avec à la clé les conséquences juridiques évoquées plus haut.
C’est pourquoi une expertise bioacoustique fiable est indispensable pour les inventaires de chauves-souris. Les bureaux d’études ont tout intérêt à développer ces compétences en interne ou à s’entourer de spécialistes afin de fiabiliser leurs diagnostics. Des logiciels d’analyse automatique des ultrasons existent (p. ex. Sonochiro, Tadarida, Kaleidoscope©), mais ils doivent être utilisés par des écologues formés, capables de vérifier et affiner les résultats. Un inventaire acoustique bien mené est la garantie que toutes les espèces de chauves-souris présentes ont été correctement détectées et identifiées, et donc que le dossier réglementaire pourra être instruit sans vice ni mauvaise surprise ultérieure. (par exemple la découverte impromptue d’une colonie non détectée qui viendrait compromettre le projet).
Pour acquérir cette expertise, la formation à la reconnaissance acoustique des chauves-souris s’avère un investissement très rentable. Nous encourageons ainsi les écologues et chargés d’étude à monter en compétences sur la détermination des chauves-souris à partir de leurs sons. Par exemple, la Formation à la détermination bioacoustique des chiroptères – niveau intermédiaire proposée par Franchir un Cap (un cursus professionnalisant de 5 jours alliant cours et terrain) est une excellente opportunité pour maîtriser l’identification des ultrasons et fiabiliser vos inventaires. En vous formant aux bonnes pratiques et en restant à jour des avancées techniques, vous serez en mesure de mieux protéger les chauves-souris tout en sécurisant juridiquement les projets qui vous sont confiés. La bioacoustique n’est plus seulement un outil scientifique pointu : c’est désormais un passage obligé pour répondre aux exigences réglementaires en matière d’environnement, et un atout pour franchir un cap dans la préservation de ces mammifères fascinants.
Conclusion
En conclusion, les inventaires acoustiques de chauves-souris ne sont pas une simple formalité scientifique, mais bien une obligation réglementaire incontournable pour tout projet d’aménagement en France. Le cadre juridique (Code de l’environnement, directives européennes, loi Biodiversité) impose une prise en compte drastique de ces espèces protégées. Des études d’impact exhaustives, intégrant des suivis acoustiques appropriés, ainsi que le respect des procédures (dossier d’incidences Natura 2000, demande de dérogation le cas échéant) sont indispensables pour éviter contentieux, retards ou échecs de projets. Les exemples récents – parcs éoliens stoppés, chantiers suspendus, jugements défavorables – démontrent que négliger les chauves-souris coûte cher, tant financièrement que juridiquement. À l’inverse, en investissant dans l’expertise bioacoustique et en appliquant scrupuleusement la réglementation, il est possible de concilier développement et protection de la biodiversité. Les techniques de reconnaissance acoustique modernes, combinées à une vigilance réglementaire de tous les instants, permettent aujourd’hui de réaliser des inventaires chiroptérologiques complets et de mener à bien les projets en conformité avec la loi – pour le bénéfice de tous, y compris des chauves-souris elles-mêmes.
Liens internes utiles : n’hésitez pas à consulter nos autres articles sur le sujet, notamment Protection stricte des chauves-souris : obligations légales (le cadre réglementaire détaillé), Inventaire des chiroptères : bioacoustique vs capture au filet (comparatif des méthodes de suivi et recommandations techniques), ou encore Éolien et chauves-souris : nouveaux protocoles acoustiques (innovations pour réduire l’impact des éoliennes sur les chiroptères). Ces ressources vous aideront à approfondir chaque aspect et à mettre en œuvre des suivis acoustiques conformes à la réglementation, efficaces et respectueux des chauves-souris.